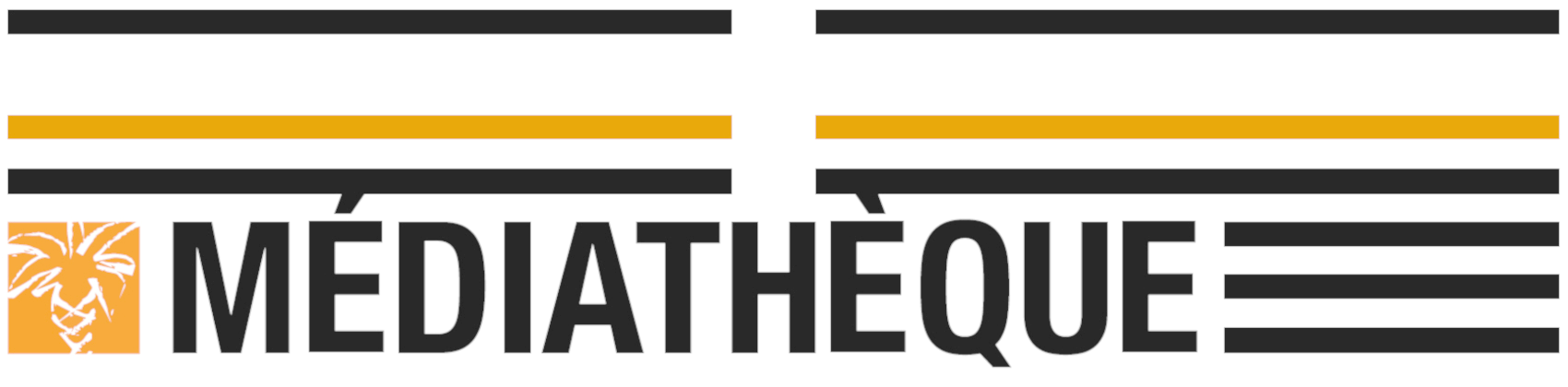Avec La fille qu'on appelle, roman qui questionne avec subtilité et pertinence la notion de consentement, Tanguy Viel offre un des meilleurs livres de cette rentrée littéraire.

Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement.
Le maire lui trouve sans problème un emploi et un studio au casino où il vient aussitôt lui rendre visite pour réclamer son dû… Comment une jeune fille « coupable » d'avoir posé en sous-vêtements pour des publicités visibles sur les abribus quand elle avait 16 ans pourrait-elle résister au maire devenu entre-temps ministre des Affaires maritimes ?
Tanguy Viel est né en 1973 à Brest. Il publie son premier roman Le Black Note en 1998 aux Éditions de Minuit qui feront paraître Cinéma (1999), L’Absolue perfection du crime (2001). En 2003, il est lauréat de la Villa Médicis. Il publie ensuite, toujours aux éditions de Minuit, Insoupçonnable (2006), Paris-Brest (2009), La Disparition de Jim Sullivan (2013) et, en janvier 2017, Article 353 du code pénal, Grand prix RTL Lire. La fille qu'on appelle était présent sur la première liste du Goncourt 2021.
 © JOEL SAGET / AFP
© JOEL SAGET / AFP
À travers une galerie de personnages soignés mêlant notables et laissés-pour-compte rappelant l’univers des films de Chabrol, le romancier breton se confronte avec beaucoup de justesse à la question du consentement enfin placée au centre des débats sociétaux – malheureusement tardivement, suite à de trop nombreuses révélations sordides.
Sans tomber dans la facilité d’un donneur de leçon ou d’un moraliste, Tanguy Viel dépeint, dans son style particulier, direct et dynamique, ce que peut être l’emprise qu’un homme, notamment lorsque celui-ci est détenteur du pouvoir, exerce sur une jeune femme perçue comme un objet. De ce point de vue, La fille qu'on appelle est un roman autant réussi que nécessaire.
« Et puis voilà, de même qu'en tectonique survient l'instant du choc, de même elle a senti sa main à lui qui se posait sur la sienne en même temps qu'il lui disait : Je vais faire ce que je peux pour t'aider. Elle a senti sa respiration se couper, comme un clou qu'on aurait enfoncé dans une horloge pour en arrêter l'aiguille, et elle n'a plus bougé pendant de longues secondes, interdite en somme, le cerveau à l'arrêt, c’est-à-dire non pas réfléchissant ni hésitant mais seulement suspendue, avec cette information nerveuse qui est bien montée là, dans son cerveau, mais s'y est bloquée, comme un ascenseur entre deux étages. » (La fille qu'on appelle, page 40)