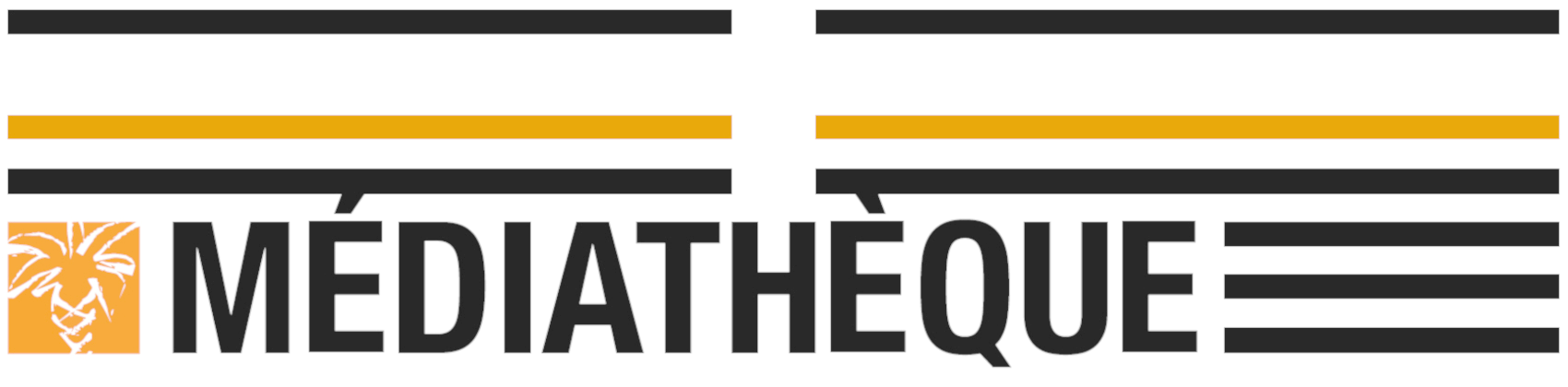Dans un documentaire exceptionnel où la dimension du temps est prégnante, le réalisateur Bill Morrison érige l’histoire d’une ville et la mémoire des images en une œuvre d’art unique et fascinante.

Dawson City, petite agglomération canadienne située au confluent du fleuve Yukon et de la rivière Klondike, devient le centre névralgique de la ruée vers l'or immortalisée par Charlie Chaplin et une inspiration romanesque de Jack London. Des milliers de prospecteurs et de chercheurs y affluèrent et bâtirent cette nouvelle ville minière qui a prospéré au gré de son exploitation d'or pour finalement tomber en désuétude.
En 1978, alors que le conducteur d'une pelleteuse effectuait des travaux de rénovation, 533 boîtes de pellicules nitrate furent déterrées d'un site qui abritait jadis une patinoire. Bill Morrison nous convie à un voyage étonnant à travers l'histoire de ces précieuses bobines de fictions et d'actualités datant de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle.
Malgré une œuvre riche d'une trentaine de films, Bill Morrison, cinéaste et artiste américain, reste méconnu en France. Sa méthode de travail s'articule essentiellement autour du found footage qui consiste à réutiliser des matériaux anciens (des images d'archives ou des vieux films) afin de leur donner une interprétation personnelle dans un contexte nouveau.

Cet art du remploi lui a permis de trouver un public plus large avec Decasia (2002) qu’on peut rapprocher de Dawson City (2016). Il explore sur plusieurs niveaux la décomposition physique des nitrates corrélativement liée à la faculté de mémoire et de nostalgie qu'elle implique. Dawson City ne déroge pas à cette esthétique mais reste néanmoins le film le moins expérimental et le plus didactique de son auteur.
Le dispositif filmique de Dawson City s’organise autour d’un montage chronologique où les extraits successifs des films muets et inédits viennent illustrer l'histoire sociale, économique et culturelle de la ville. A l'exception du préambule et du dénouement du documentaire qui aident à contextualiser certains événements, il n'y a aucun témoignage. Aucun commentaire non plus ne vient parasiter les extraits de films et les photographies d'époque : les images sont toutes datées et légendées.

Rien n'échappe au temps mais le paradoxe propre au cinéma est de restituer un passé figé, rescapé de la combustion. Avec l'avènement du cinéma parlant, quand elles n'étaient pas abandonnées au fleuve ou détruites par les nombreux incendies (la pellicule nitrate est hautement inflammable), les films considérés comme obsolètes après leur projection, et rarement renvoyés aux studios de production, étaient jetés dans le bassin de l'ancienne piscine qui tenait également lieu de patinoire. Pendant plus d'un demi-siècle, le pergélisol a miraculeusement conservé ces bobines, et le sous-titre original du documentaire, frozen time (le temps gelé) prend de fait tout son sens.
Bill Morrison nous invite à une chasse au trésor géminée où les bobines exhumées et l'or convoité s'unissent pour nous offrir une pépite cinématographique inestimable.
Cette résurrection est jubilatoire.