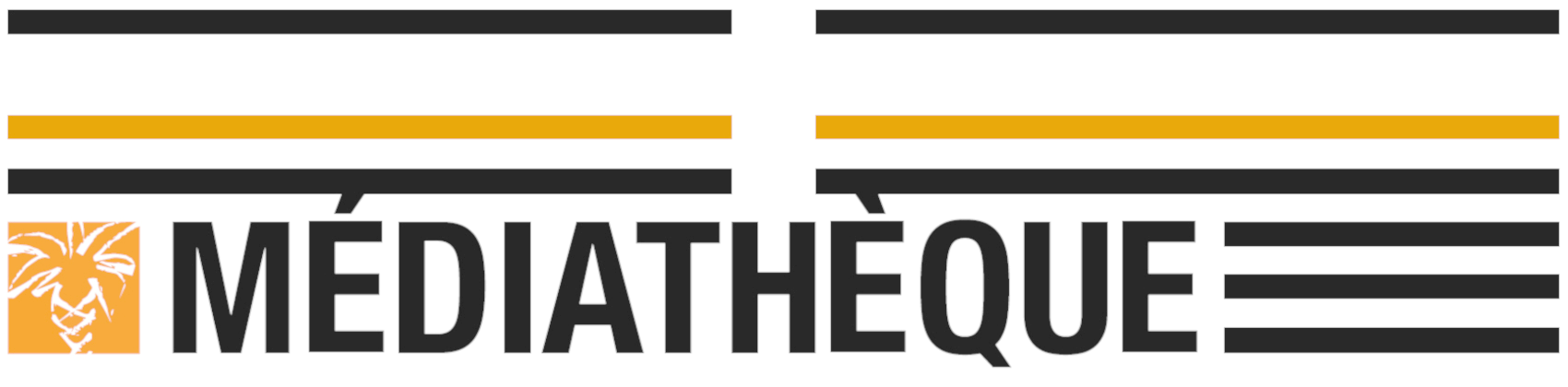Plus qu’un film de science-fiction à l’esthétique un peu kitsch ayant obtenu le Grand prix spécial du jury au festival de Cannes en 1972, Solaris est une œuvre métaphysique transcendant le cinéma.

Lorsque, après les déboires d’Andreï Roublev, son précédent film, il propose Solaris aux autorités soviétiques, le réalisateur Andreï Tarkovski sait que le crédit que lui avait apporté L’enfance d’Ivan, sa toute première réalisation, s’est envolé et que son adaptation du roman de Stanislas Lem risque d’être refusée. Mais, en pleine conquête spatiale, l’URSS valide cet ambitieux projet susceptible de répondre au 2001, l'odyssée de l'espace de Kubrick.
Le tournage de Solaris peut débuter. Tarkovski qui, paradoxalement, apprécie guère la science-fiction, envisage de se consacrer uniquement à ses personnages et leurs troubles, sans se soucier du réalisme spatial du décor – les sas et les machines – qui, il le sait, vieillira mal. Problème : c’est principalement cela qui intéresse les autorités soviétiques. S'en suivent alors de longs mois de bataille avec la Goskino (Comité d'État pour le cinéma) aboutissant à de nombreuses coupes qui éreintent le moral du cinéaste russe. Mais, au bout du compte, le film est terminé et distribué.

Solaris est une planète intelligente recouverte d'un océan qui projette et matérialise les souvenirs et les regrets de ceux qui s'en approchent. Depuis la découverte de la planète, une station en orbite accueille un groupe de scientifiques cherchant à percer son mystère. Mais ces derniers, pris de démence, mettent en péril la mission. Le docteur Kris Kelvin, un homme bouleversé par le suicide de sa femme, est envoyé sur Solaris pour examiner les scientifiques et déterminer s'il faut fermer la station. Mais il est à son tour victime des projections de Solaris.
Dès son arrivée dans la station, malgré ses errances hallucinatoires, Kris ne cherche pas à comprendre le phénomène qu’il accepte. Pour lui, la « vérité » ne réside pas dans le mystère du fonctionnement de Solaris, mais plutôt dans ce que racontent des humains les images produites par la planète. Ou, pour le dire autrement : la vérité ne se trouve pas sur Solaris, simple révélateur de ce que sont les hommes, mais sur terre où naissent les souvenirs.

Dès le début du film, le comportement de Kris, explorateur qui hait les voyages, indique son profond enracinement terrien. Les premières images le montrent, juste avant son départ pour la station, flânant contemplatif dans son jardin, profitant de chaque seconde, frôlant les herbes avec sa main comme prêt à les agripper pour ne pas être emporté loin de sa maison.
En effet, si les corps des personnages sont envoyés dans l'espace, leurs pensées, elles, restent sur terre, demeurent attachées à la terre. Tout au fond de l'espace, c'est la terre et ce qu'il y a laissé que Kris rencontre : sa défunte épouse avec qui il poursuit sa vie maritale, d'abord, puis sa mère lorsque, pris de fièvre, le voilà à nouveau, mais adulte, dans la datcha de son enfance auprès de sa mère qui le soigne et le réconforte.

Tarkovski film le temps retrouvé, le passé désormais immortel qui se régénère comme se régénèrent les « visiteurs » envoyés dans la station par Solaris. Forcément, le cinéaste se demande aussi quelle serait son apparition ? Lequel de ses désirs s'exprimerait grâce à Solaris ? Pour Tarkovski, déjà nostalgique, c’est revoir la maison de campagne de son grand-père – dont la datcha de Kris est la parfaite reproduction –, puis celle dans laquelle sa mère, sa sœur et lui ont été envoyés durant la guerre (comme s’il pressentait l’exil et le déracinement dont il sera bientôt l’objet).
Alors, à l’instar du Marcel d’À la recherche du temps perdu, Tarkosvki fige littéralement ce souvenir de la maison d’enfance dans une portion de « temps à l’état pur » : à la fin du film, Kris est de retour chez lui et retrouve sa maison. Puis, grâce à un vertigineux zoom arrière en plongée, la caméra s'éloigne de la maison, du jardin et des arbres, de l'étang et d'un bout de route pour permettre de voir que l’ensemble est un îlot de souvenir formé à la surface de Solaris dans lequel il est possible d'habiter éternellement. Voilà le rêve de Tarkovski : habiter éternellement la datcha de l'enfance.