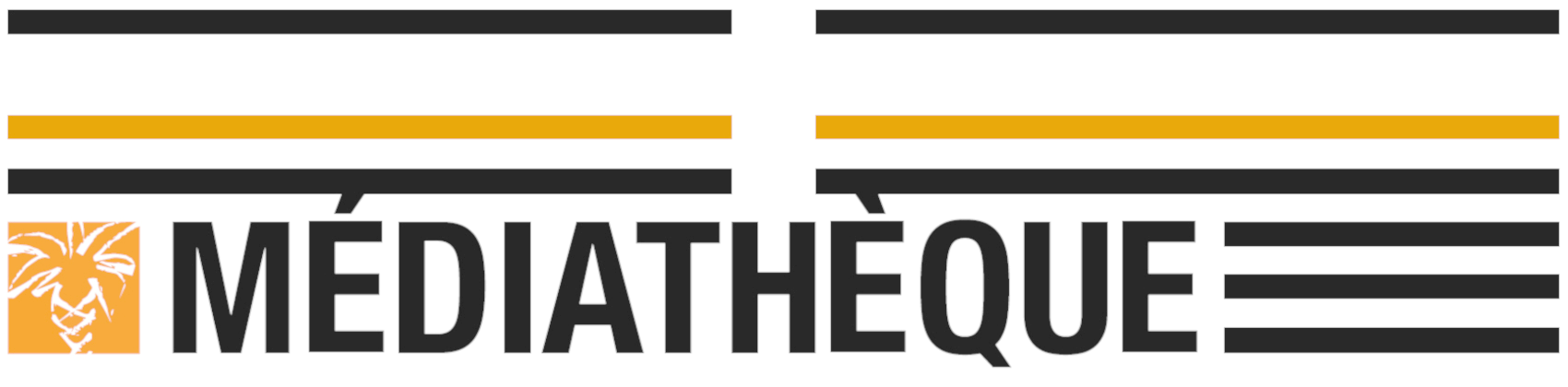Lauréat du prix de la Critique internationale en 1985, Visages de femmes est le premier film africain à avoir obtenu cette récompense au festival de Cannes. Il décrit une société en transition malgré un passé tenace, profondément ancré.
Nous suivons deux femmes de génération différente, l’une portée par l’émotion, l’autre par la réflexion, lesquelles tentent d’accéder à plus de reconnaissance dans une lutte exaltée d’émancipation.

La filmographie compendieuse de Désiré Ecaré ne comprend que trois films réalisés entre 1967 et 1985. Son premier court métrage Concerto pour un exil remporte le prix du jeune cinéma à Hyères, tandis que A nous deux France y obtient le prix spécial du jury en 1970.
Censuré à sa sortie en Côte d’Ivoire - son pays d’origine -, Visages de femmes a suscité la curiosité grâce à une scène d’amour torride, totalement inédite dans la tradition puritaine du cinéma africain. Mais Désiré Ecaré est plus soucieux d'établir des liens entre les luttes sociales et le féminisme émergent en se concentrant sur le statut de femmes engagées dans de nouvelles revendications égalitaires.
Le film se divise en chroniques rurales et urbaines entrecoupées, au village, de danses et de chants rituels impulsés par un groupe de femmes ; en ville, de marches militaires et de cours de karaté. Ces transitions dynamisent le récit par la vitalité des expressions corporelles offrant à Visages de femmes une formidable étude de la lutte entre un passé africain qui ne lâche rien et un avenir qui peine à abolir l’emprise patriarcale.

La première histoire se concentre sur une jeune femme qui, lassée d'être dirigée par son mari, devient la maîtresse du jeune frère de ce dernier. Brou considère N’Guessan, son épouse, comme sa propriété, pratique la polygamie, et punit les femmes qui expriment leurs désirs. L’homme est hostile et méfiant tandis que la distance qui se crée progressivement entre eux donne à son frère impatient l’opportunité de séduire sa belle-sœur. Il est terriblement inquiet de perdre non seulement sa femme, mais également le respect de sa communauté et la position dominante qu’il occupe au sein du foyer. Son autorité vacille, l’épouse dévouée et servile se rebelle, si bien que l’adultère peut être perçu comme un acte politique. La scène d’amour est belle, drôle, aérienne ; la nature tranquille et la rivière bienveillante s’érigent comme antidote aux conventions et à l’oppression patriarcale. Les amants sont égaux. La femme elle, ne sera jamais l’égal de son mari dans son désir de renaissance et d’indépendance, toutefois N’Guessan trouvera son salut dans l’apprentissage du karaté, discipline qui cimente l’enchaînement des deux histoires. N’Guessan et Bernadette sont inscrites dans le même cours : l'une recherche la force physique tandis que l’autre recherche la force économique.

Le statut accordé à ceux qui réussissent professionnellement assure à la deuxième histoire une autre voie à suivre. Soutien familial et chef d’entreprise d’une fabrique de poissons dont les privilèges reviennent à sa belle-famille, Bernadette est excédée de se subordonner au rôle « supérieur » que la tradition confère à son mari et encourage ses trois filles à s'autonomiser. Compte tenu des liens patriarcaux existant entre le capitalisme, l’impérialisme et le colonialisme, Bernadette travaille dur mais ne reçoit pas le respect qu'elle mérite de la part de sa famille et de la banque. Elle est assez naïve pour penser qu’elle peut contester sa position grâce à une éventuelle ascension. Son entreprise lui permet de subvenir à ses propres besoins, à ceux de son conjoint, de ses filles et d’un jeune frère. Tandis que les filles ne s'inquiètent pas de leur avenir puisqu’elles pensent que leur mère les soutiendra toujours et que leur beauté leur permettra de manipuler les hommes, le mari indolent préserve sa position d’autorité et de pouvoir au sein de la famille. A tort, Bernadette espère qu'en gagnant encore plus d'argent en étendant son commerce, elle s’attirera naturellement la révérence de sa famille et de la collectivité, dans la perspective d’améliorer sa visibilité publique et de renforcer la reconfiguration de la hiérarchie familiale. Mais sa logique patriarcale est un leurre.

Ces deux histoires illustrent bien la double norme d’une société africaine contrastée. Les différents récits dépeignent la lutte perpétuelle de femmes à s’élever contre les injustices, et le combat qu’elles mènent pour se libérer du rôle qu’on leur a attribué. Le conflit non résolu entre les aspirations de la femme et les prérogatives maritales de l’homme qui cherche à la retenir dans le giron réactionnaire de la famille exige une endurance nébuleuse.
A travers l’échec des deux personnages principaux, la voie la plus probable vers le succès est le chœur des femmes qui s’unissent pour former une seule voix de protestation dans les chants qu’elles célèbrent. Car, en associant la voix de N'Guessan à celles des autres femmes, le chœur implique la force politique numérique qui sera peut-être nécessaire pour repousser la structure patriarcale et le fondement culturel ancestral qui permettent à un homme d’avoir de l’ascendant sur une femme.