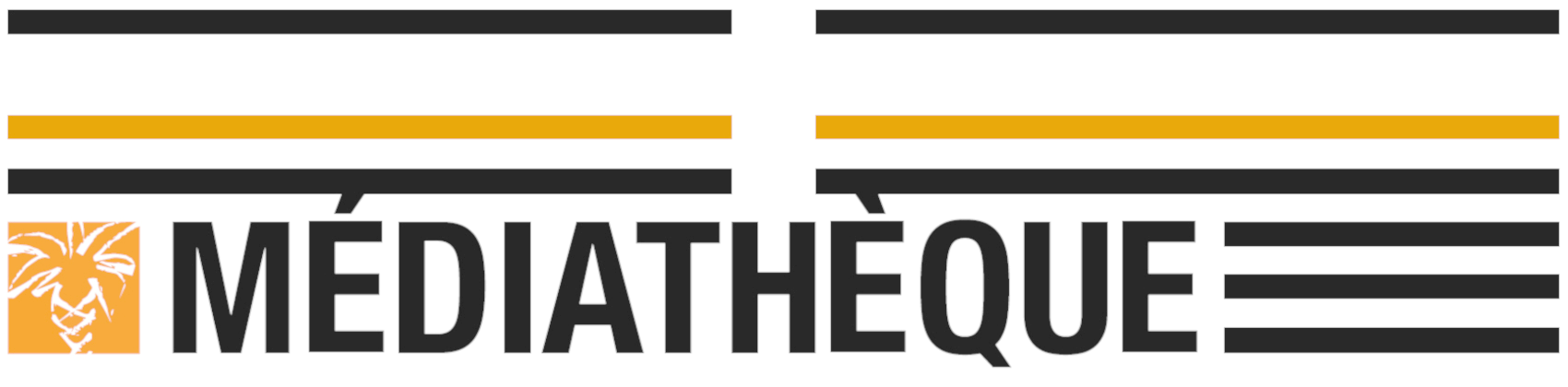De tous les grands écrivains ayant déposé leurs valises à Hyères, Joseph Conrad est peut-être celui dont l’œuvre bénéficie aujourd'hui de la plus vaste notoriété. Avec des indépassables classiques tels que Au cœur des ténèbres et Le Nègre du Narcisse, mètre-étalon du récit maritime, l'influence du britannique n'a cessé de croître au cours du XXème siècle.
Né Teodor Jozef Konrad Korzeniowki le 3 décembre 1857 à Berditchev en Ukraine, issu de la noblesse polonaise, Jospeh Conrad voit ses parents être déportés en raison des activités politiques de son père, Apollon Nalecz Korzeniowski, auteur dramatique, traducteur et militant pour la libération de la Pologne, à cette époque sous le joug russe. Le jeune garçon est alors confié à son oncle maternel habitant en Cracovie. Dès son plus jeune âge fasciné par la géographie et les voyages, Conrad embarque en 1874 comme mousse sur un voilier au départ de Marseille, puis s'engage successivement sur divers navires de commerce qui le mènent jusqu'aux Antilles.
Quand il rentre à Marseille, où il fréquente les milieux légitimistes et aristocratiques, Conrad est accueilli par une famille polonaise émigrée dans la Citée phocéenne, les Chodzko, dont l'une des filles, Thérèse, a ouvert avec son mari, le docteur Benjamin Millot, un "institut climatologique" à Hyères où ils reçoivent de nombreux russes et polonais. Une visite de l'institut permettra à Conrad de fouler pour la première fois le sol hyérois. Si une passionnée, mais douloureuse idylle avec Thérèse lui fait percevoir avec davantage d'attachement la ville d'Hyères, le futur écrivain ne s'y attarde pas. Bientôt, c'est même Marseille qu'il quitte déçu pour, entre deux longs voyages en mer, s'installer en Angleterre.

Lorsqu'il débarque, Conrad ne connaît pas un mot d'anglais, une langue qu'il va apprendre, tandis qu'il fait du cabotage entre Lowestoft et Newcastle, en lisant Shakespeare. Bien vite, il reprend les grandes traversées qui le mèneront jusqu'à Bombay et Sydney, en écumant au préalable tous les ports italiens. Engagé dans la marine marchande britannique, il obtient la nationalité anglaise et le grade de capitaine ne 1886. C'est à cette époque qu'il se met à écrire - tout de suite en langue anglaise - en participant notamment à un concours organisé par une revue pour laquelle il rédige un récit intitulé Le Matelot noir et entame ce qui sera son premier roman : La Folie Almayer.
La vie de marin est toujours plus forte que l'écriture. Jusqu'en 1894, il sillonne les mers, connaît des traversées périlleuses et de nombreuses maladies qui lui font mettre pied à terre, puis découvre Singapour, Bornéo et l'Île Maurice où, lors d'une halte forcée, il s'éprend d'une jeune femme, Eugénie Renouf. Conrad la demande en mariage avant d'apprendre qu'elle est déjà fiancée. Effondré, il retourne à Londres où il reprend son roman. Mais le goût de l'aventure l'emporte encore sur l'écriture : il prend le commandement d'un vapeur du Haut-Congo et se lance dans une expédition extrêmement dure et éprouvante pour son corps perclus de rhumatismes, ce qui, au bout de quelques mois, le contraint à rentrer en Europe.

Il met un point final à La Folie Almayer : Histoire d’une rivière d’Orient, en 1895. Le relatif succès du livre le convainc de se consacrer à la littérature. Désormais marié à Gessie George, définitivement installé en Angleterre, Conrad va, sous le patronage de Ford Madox Hueffer, écrire et publier plusieurs chefs-d’œuvre, dont Un paria des îles, Lord Jim, Au cœur des ténèbres, Typhon ou encore Nostromo, et ce, en dépit de la maladie et de ses difficultés financières. Outre son talent pour l'efficacité de ses trames romanesques et la justesse de ses descriptions, on lui doit d'avoir introduit, dans le roman d'aventure et le récit maritime, une réelle profondeur d'analyse psychologique et une forte charge symbolique qui font de lui un des plus grands romanciers de l'histoire de la littérature.
Bien que sujet à une dépression depuis quelques années, Conrad reprend la mer pour un bref laps de temps durant la Première guerre mondiale lorsque l'Amirauté britannique lui confie un service côtier. La guerre terminée, ce grand voyageur découvre paradoxalement sur le tard les États-Unis en débarquant à New York en 1923. Ce sera son dernier voyage : un an plus tard, de retour dans le Kent, usé, fatigué, Joseph Conrad meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans.

Mais avant de partir pour New York, Conrad fit, après un séjour en Corse, une escale à Hyères en avril 1921, en répondant à l’invitation d'Edith Wharton qui le reçut au Castel Sainte-Claire. Afin de boucler la boucle et, peut-être, raviver les vestiges de son amour pour Thérèse et ses souvenirs douloureux, il parcourt la presqu'île de Giens dont la beauté l'enthousiasme en lui rappelant sa jeunesse. Les paysages arbanais vont lui inspirer la rédaction de son dernier roman, Le Frère-de-la-Côte, publié sous le titre The Rover en 1923.
Avec la presqu'île de Giens pour cadre, le lecteur suit les aventures de Jean Peyrol qui, après 50 ans de vie maritime, revient sur les lieux de son enfance, à "l'extrémité de la presqu'île, qui comme une jetée colossale, sépare la pittoresque rade d'Hyères des caps et des anses qui forment les approches du port de Toulon". Sous la Convention et le Consulat, à une époque où français et anglais se livrent bataille pour avoir la main mise sur la Méditerranée, Le Frère-de-la-Côte alterne aventures et rivalités politiques dans lesquelles sont entrainés les personnages : un tourbillon que Jean Peyrol n'évitera pas. Ce sera face aux Îles d'Hyères, au large de Giens, que cet ancien forban, ultime héros de Conrad, mènera son dernier combat. Et conclura magnifiquement une œuvre immense.