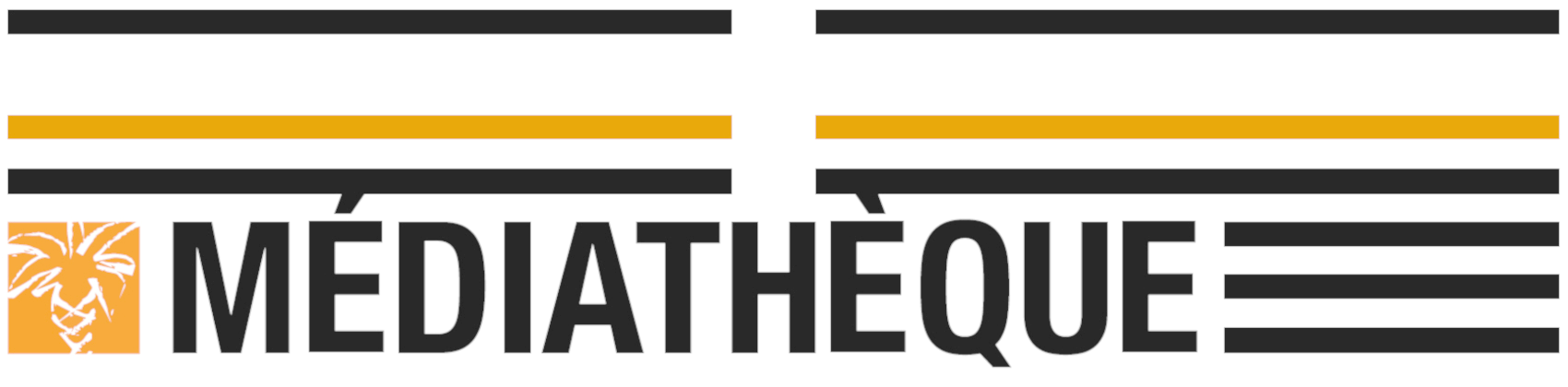L'histoire de la découverte d'une tomate très particulière et de sa culture à Hyères par un jardinier chevronné.
En 1862, est présenté aux deux chambres du Parlement anglais un rapport relatif aux îles Fidji où des missionnaires britanniques oeuvrent depuis plusieurs décennies pour évangéliser les populations. Ce rapport comporte un appendice signé d’un certain Dr Seeman qui aborde notamment les légumes qui sont cuisinés lors des repas au cours desquels de la chair humaine est – de plus en plus rarement – consommée. Il rapporte ainsi qui lui a été assuré à plusieurs reprises que la digestion est particulièrement difficile et qu’afin de la faciliter, ce mets funeste est toujours servi avec des légumes dont les trois principaux sont : des feuilles de Malawari (Trophis anthropophagoriim), du Tudana (Omalanthus pedicellatus) et du Borodina. Seeman identifie – justement – le Borodina à l’immense famille des Solanacées et nomme la plante Solanum anthropophagorum. Il décrit ensuite la plante : il s’agit d’un arbuste touffu, au feuillage sombre et luisant et qui donne des fruits de la forme et de la couleur des tomates. Le fruit a une légère odeur aromatique et il est cuisiné par les Fidjiens comme de la sauce de tomate qui est aussi une solanée (Solanum lycopersicum) comme la pomme de terre (Solanum tuberosum) ou l'aubergine (Solanum melongena). À son retour des îles Fidji, Le docteur Seeman en confie des graines aux jardins royaux qui s’essaient à l’acclimatation de la plante dont les jardiniers considèrent au final qu’elle ne possède aucune qualité qui puisse engager à la cultiver.
Au XIXe siècle, l’acclimatation de plantes nouvelles est plus que jamais une des grandes activités des jardins botaniques qui rivalisent mais s’entraident aussi afin de propager les plantes nouvellement découvertes au cours des missions d’explorations. Les graines circulent alors de jardin en en jardin et c'est ainsi que paraît, en 1867, dans la fameuse Revue Horticole, un court article signé Victor Rantonnet dans lequel celui-ci annonce avoir réussi à cultiver et faire fructifier, à Hyères, la tomate utilisée par les Fidjiens au cours de leur rite anthropophage.
 Solanum anthropophogarum
Solanum anthropophogarum
(Curtis's Botanical Magazine)
Victor Bathélémy Rantonnet (1797-1871) n’est pas un inconnu pour les lecteurs fidèles de la revue : ceux-ci peuvent en effet lire ses réussites et ses exploits en matière d’acclimatation depuis trois décennies déjà. Né à Lyon, il s'installe à Hyères en 1824 ; à la fois horticulteur, grainier, fleuriste et pépiniériste, il y fonde le premier établissement horticole de la ville d’Hyères dont le rayonnement dépassera largement les frontières de ce qui ne s'appelle pas encore la Côte d'Azur ou la Riviera. Ses compétences en matières d’acclimatation et de reproduction des espèces exotiques vivaces ou annuelles se retrouvent exposées dans le catalogue qu’il fait paraître chaque année et dans lequel plantes africaines, américaines mais aussi australiennes devenues depuis pour ainsi dire endémiques sont proposées dès les années 1830. Rantonnet est un jardinier accompli et il n’est donc pas étonnant que sous le climat d’Hyères « dont la douceur a une réputation européenne » - ainsi qu’il l’écrit dans l’introduction de son catalogue de 1836 – il ait aisément réussi à faire pousser et fructifier la tomate des anthropophages fidjiens. Contrairement à ses confrères britanniques, il considère que « cette nouvelle variété de tomate pourrait entrer dans la consommation générale, surtout dans la France méridionale », après l’avoir débarrassé du « nom odieux dont ont l’a malheureusement doté » pour « l’appeler tout simplement Solanum fidjianum (tomate des îles Fidji.) »
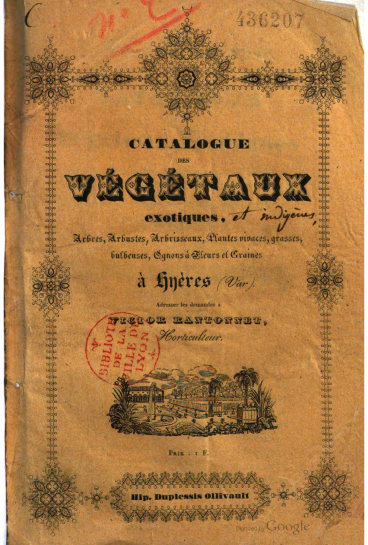 Catalogue des établissements Rantonnet de 1836
Catalogue des établissements Rantonnet de 1836
L’histoire – la botanique – n’a pas retenu la proposition de Rantonnet à qui un Solanum rend d’ailleurs hommage (Solanum rantonnetii) et la tomate des anthropophages est désormais connue sous le nom de Solanum uporo. Elle est principalement cultivée par curiosité, en référence à l’utilisation funeste qui en était faite jadis dans les îles du Pacifique. Quant à Rantonnet, s’il est inconnu du grand public, sa postérité est immense : ce sont lui et ses continuateurs (Charles Huber et François Nardy à Hyères, Ludwig Winter à Hyères puis Bordighera, Gustave Thuret et Charles Naudin à Antibes, etc.) qui ont contribué à façonner le paysage végétal de la Côte d’Azur et de la Riviera.

Solanum rantonnetii