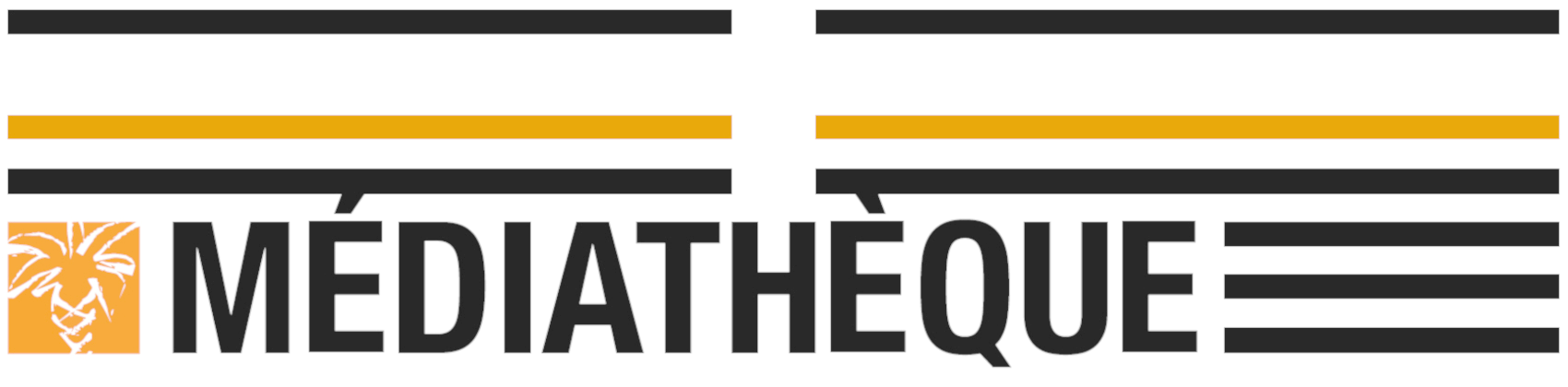George Cuvier (1769-1832), père de la paléontologie, est considéré comme un des plus grands savants de son temps. Surnommé l'Aristote du XIXème siècle, il a aussi donné à la zoologie une classification naturelle et l'anatomie comparée lui doit de significatives avancées.
Issu d'une famille montbéliarde modeste, Cuvier est admis en tant que boursier en 1784 à l'Académie Caroline de Stuttgart, fondée par le Duc de Würtemberg - qui était aussi comte de Montbéliard - pour l'éducation des fils de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Il y manifeste très tôt un goût prononcé pour les sciences naturelles et fonde une Société d'Histoire Naturelle. Faute de moyens pour rentrer chez ses parents, il consacre tout son temps libre hors de l'université à collecter plantes et insectes, et à consigner ses découvertes et observations dans des cahiers qu'il appelle Diarium. Il y décrit et dessine à la plume toutes les espèces animales et végétales qu'il rencontre au cours de ses promenades. Réhaussés à l'aquarelle, les dessins sont d'une grande précision, tout comme les observations et commentaires qui les accompagnent. Entre 1786 et 1791 le jeune Cuvier exécute ainsi 10 cahiers : cinq Diarium botanicum et cinq Diarium zoologicum.
En 1795, remarqué pour plusieurs articles pertinents, il est appelé à Paris par Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Membre de l'expédition scientifique qui a accompagné Napoléon en Egypte, Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle dont il occupe la chaire de zoologie, celui-ci va diffuser auprès de ses collègues les recherches de cet autodidacte et l'introduire auprès des institutions scientifiques de la capitale. Il lui demande de lui communiquer ses Diaria mais Cuvier est réticent : "ils ne sont qu'à mon usage et ne comprennent que des choses écrites ailleurs et mieux établies par les naturalistes de la capitale. [...] Ils sont faits sans le secours des livres et des collections." Par la suite, ils signeront ensemble plusieurs mémoires d'histoire naturelle avant de se brouiller violemment au sujet de la théorie de l'évolution des espèces.

Professeur au Collège de France, professeur d'Anatomie comparée, Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Inspecteur Général de l'Instruction Publique, Conseiller d'Etat, Cuvier mène une brillante carrière scientifique et administrative jusqu'à sa mort en 1832. Figure intellectuelle majeure de l'époque des Lumières, Georges Cuvier reste ainsi dans l’Histoire des sciences comme l’un des pères de l’Anatomie comparée et comme le fondateur de la Paléontologie. Après sa mort, son neveu Frédréric-Georges Cuvier (1803-1893) donne à la Bibliothèque de l'Institut de France une grande partie de ses papiers et archives parmi lesquelles les précieux Diaria qu'il a conservé tout au long de sa vie et que nombre de ses contemporains (V. Audoin, E. Geoffroy Saint-Hilaire, Dareste, Laurillard...) ont évoqué à plusieurs reprises. Or, si la série botanique est complète de ses cinq volumes, deux volumes - le I et le V - manquent à celle consacrée à la zoologie. Pendant des années on va chercher à retrouver la trace de ces cahiers mais sans succès ; ils sont considérés comme perdus.
En 1957, Philippe Knoepffler - naturaliste - effectue des recherches à ce qui n'est alors que la bibliothèque municipale d'Hyères. Il découvre dans la Réserve (qui abrite les documents les plus précieux de la bibliothèque) un cahier de notes manuscrites accompagnés d'illustrations réalisées à l'aquarelle. Sur la page de titre on lit : Diarium zoologicum praesentim entomologicum exhibens Animalia in hyeme 1786-1787 a D. de Marshall et me examinata illorumque descriptiones et effigies ad vivum depictas. Stuttgardiae 29 Jan. 1787. Au bas de la page, figure la signature suivante : G. L. Cuvier. Le premier cahier de notes zoologiques de Cuvier, le Diarium zoologicum I, le plus précieux de tous les carnets car le plus ancien, vient de refaire surface.
L'événement est considérable et la presse nationale s'en fait l'écho :

Le Figaro (07/02/1958)
La communication évoquée dans l'article du Figaro décrit le carnet en ces termes :
"Chaque page du cahier était pliée en deux dans le sens de la longueur. La moitié gauche était réservée à la descriptions des espèces, la moitié droite à des annotations diverses, des corrections, des discussions, tout cela ajouté au cours des années suivantes et écrit parfois au crayon, selon une habitude de Cuvier, d'une écriture généralement plus ramassée et plus ferme. On y trouve des renvois aux Diaria suivants (III, IV, V), ce qui montre bien que lorsque Cuvier rédigeait son Diarium quintum (1791), il ne s'était point encore désaisi du Diarium primum. [...]
Le manuscrit d'Hyères présente encore l'intérêt d'offir les premiers dessins d'Histoire naturelle de Cuvier. Les 11 planches sont remarquables par la délicatesse des traits, l'exactitude de détail, la représentation incomparable des couleurs."