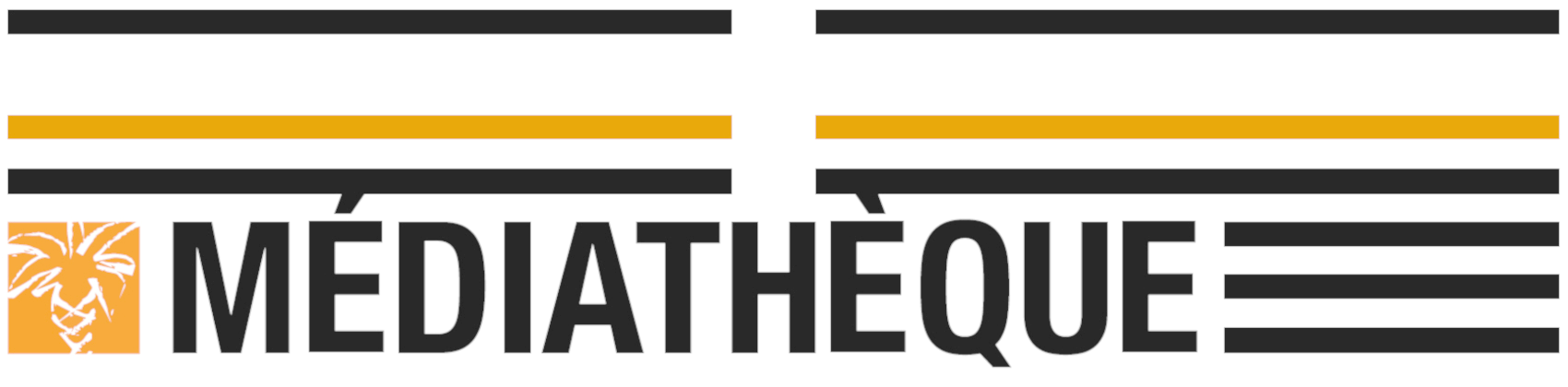En 1785, Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, prend la tête d'une expédition commanditée par Louis XVI. Les trois premières années, l'expédition fait régulièrement parvenir de ses nouvelles. Jusqu'en 1788 et que vaisseaux et équipage disparaissent.
L'expédition avait été entreprise afin de poursuivre la voie ouverte par Cook vers l'Amérique du Nord et l'Océan Pacifique afin de déterminer le potentiel commercial des zones nouvellement découvertes. L'Astrolabe et La Boussole visitèrent ainsi le Chili, l'île de Pâques, les îles d'Hawaï, l'Alaska, la Californie puis, traversant le Pacifique d'est en ouest, rejoint Macao. L'équipage visite ensuite Manille, parcourt les mers de Chine et du Japon, puis après s'être dirigé vers le sud, accoste les îles Samoa puis Tonga. En janvier 1788, l'expédition fait halte à Botany Bay en Australie. Elle en repart en mars et disparaît.

Portrait du comte Jean-François de Galaup de La Pérouse par Geneviève Brossard de Beaulieu
L'émoi est considérable à la tête du pays et au sein de la Marine royale. À nouveau ordonnée par Louis XVI, une expédition de recherche est mise sur pied dans les années qui suivent la disparition de La Pérouse. Confiée à Antoine Bruny d'Entrecasteaux (le "chevalier d'Entrecasteaux"), elle compte 219 hommes d'équipages répartis entre La Recherche et L'Espérance. Un grand nombre de savants embarquent également à bord des deux frégates : médecins, ingénieurs hydrographes, géologues, astronomes, botanistes... L'expédition doit explorer l'Océanie où l'on suppose que L'Astrolabe et La Boussole ont disparu mais elle doit aussi être utile à la navigation, à la géographie, au commerce, aux arts et aux sciences.

La Recherche et L'Espérance par François Roux
La première escale se fait aux Îles Canaries, la suivante dans la colonie du Cap. La traversée de l'Océan Indien est ensuite entreprise et la Tasmanie, au large de l'Australie, est atteinte un mois plus tard. À terre, les hommes découvrent des cygnes noirs et des plantes jusque-là inconnues. L'équipage scientifique s'affaire dans tous les sens : on prélève, on compare, on classe, on mesure, on dessine... tandis que Félix Delahaye, le jardinier de l'expédition, crée, sur le modèle du jardin botanique de la Compagnie des Indes Orientales du Cap, un jardin pour nourrir les hommes embarqués sur La Recherche et L'Espérance et ceux appelés à venir à bord d'expéditions futures. Cap est ensuite mis vers la Nouvelle-Calédonie puis vers les îles de l'Amirauté ou des hommes en uniformes auraient été aperçus. Mais il n'y a toujours aucune trace de La Pérouse et de ses hommes. D'Entrecasteaux décide ensuite de se diriger à nouveau vers l'Australie, puis vers la Nouvelle-Zélande avant de poursuivre vers les îles Tonga (anciennement "îles des Amis") où le réapprovisionnement est effectué. Chaque escale est l'occasion pour les savants de descendre à terre pour faire avancer la science et la connaissance.
Le 6 mai 1793, le commandant en second de l'expédition, Jean-Michel Huon de Kermadec meurt d'épuisement. D'Encasteaux décide néanmoins de poursuivre sa mission : il retourne en Nouvelle-Calédonie mais, en l'absence de traces et de témoignages, il reprend la mer vers les îles Salomon avant de longer les côtes de la Nouvelle-Guinée. Puis ce se sont les îles Portland, de l'Amirauté, Anachorètes... Le 21 juillet 1793, D'Entrecateaux meurt à son tour, du scorbut, cette maladie due à une carence en vitamine C et qui ravage son équipage depuis plusieurs semaines. Malgré la disparition de son capitaine, l'expédition se poursuit - jusqu'en août 1793 - quand les Hollandais, en guerre avec la France, saisissent les deux frégates.
Sur deux-cent-dix-neuf membres que comptait l'expédition à son départ de Brest en septembre 1791, seuls quatre-vingt-neuf survécurent. Certains, des savants suspectés de sympathies révolutionnaires, seront arrêtés sur l'île de Surabaya (Indonésie) par les autorités néerlandaises le 21 décembre 1793, emprisonnés sur la lointaine île de Java et leurs travaux et collections confisqués puis envoyés en Angleterre. Parmi ces hommes, au nombre de sept, se trouve Jacques-Julien Houtou de la Billardière, botaniste, qui n'est libéré que le 9 germinal de l'an III (29 mars 1795). Il gagne alors l'île de France (l'île Maurice) et le jardin botanique de Pamplemousse où il est hébergé. Ses collections - contenant plus de quatre milles plantes dont un très grand nombre étaient jusqu'alors inconnues - ont été confisquées et envoyées en Angleterre. Il demande alors au botaniste anobli Sir John Banks qui fut son maître d'études d'intercéder en sa faveur et finit par récupérer ses collections - intactes - et rentre à Paris en 1796.
En 1800, ayant remis de l'ordre dans ses affaires, il publie une relation - un compte-rendu - de cette expédition à la recherche de La Pérouse et des découvertes qu'il a faites en Océanie. Il y est bien évidemment question de flore et de faune, mais aussi des peuples indigènes rencontrées lors des expéditions et leurs outils. Les deux volumes in-4 de texte qui le composent sont accompagnés d'un grand atlas in-folio (475 x 310 mm) de 43 planches d'histoire naturelle, de paysages et de portraits d'indigènes. Y figurent, notamment, le cygne noir ainsi que deux espèce d'eucalyptus inconnus jusqu'alors, l'Eucalyptus globulus et l'Eucalyptus cornuta (observés en Tasmanie) ou des portraits d'hommes et femmes des nombreuses îles australasiennes visitées par l'"Expédition d'Entrecasteaux" au cours de son périple (Tonga, Tongatapu, Fidji, Nouvelle-Zélande, Amboine ou encore Amirauté). L'ensemble est saisissant tant les gravures réalisées à partir des dessins ramenés de l'expédition (et réalisés sur un papier de très grand format que s'était procuré la Billadière avant d'embarquer) sont exceptionnelles de précision.
Comme de nombreux livres anciens conservés dans les réserves de la médiathèque, les deux volumes de texte ainsi que l'atlas portent l'estampille d'Alphonse Denis qui - bien que passionné de botanique, sa bibliothèque en atteste - était plus généralement fasciné par l'Orient, ce concept culturel européen qui servait alors à désigner toutes les contrées situées - peu ou prou - à l'Est de l'Europe, et possédait un grand nombre de récits de voyage.
Relation du Voyage à la recherche de la Pérouse / Jacques-Julien Houtou de la Billardière
Paris, 1800.
2 volumes & un atlas : 513J BIL
L'Atlas est consultable en ligne, ici.