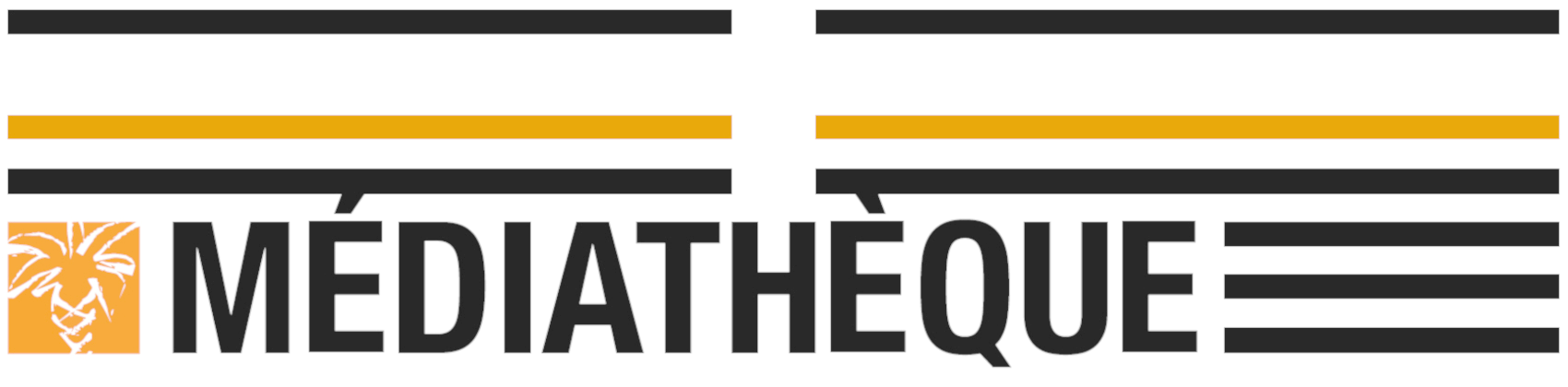Entre retranscription et mise en scène de la réalité, Echo (2019) dresse le constat d’une société occidentale (islandaise, voire parfois universelle) en pleine (r)évolution. De nombreux thèmes y sont abordés en cinquante-six fragments-témoins, imprégnés d’humour et de mélancolie.

L’Islande est un petit pays par sa population (environ 360 000 habitants) qui ne peut pas concurrencer l’industrie cinématographique des grands pays européens. Une dizaine de films sont produits chaque année et peu de cinéastes parviennent à être distribués en France. Connue principalement de quelques festivaliers, l'oeuvre de Runar Runarsson compte trois longs-métrages et plusieurs courts-métrages maintes fois primés. On l'a véritablement découvert en 2011 avec Volcano, puis avec Sparrows en 2015.
Dans Echo, la démarche semble simple. Cinquante-six tableaux, autonomes et de durées inégales, dressent l'état des lieux de l'Islande pendant une période clé, celle des festivités de Noël et du jour de l'An. Cette période en suspension et transitoire de réunion et de solidarité est souvent propice pour exacerber les émotions et les inégalités. C'est justement cette atmosphère singulière et sensible qui enveloppe le film et révèle l'individu dans toute sa diversité.

Echo est un cinéma de la vignette situé entre fiction et documentaire. Les fragments de cette mosaïque s'organisent dans un espace-temps structuré grâce à un montage subtil dépourvu de canevas narratif. Le choix esthétique du plan fixe pour chacune des saynètes encourage le regard à se focaliser exclusivement sur ce qui se joue dans le cadre, sans l’égarer, et sur la participation unique des acteurs (professionnels, ou amateurs jouant leur propre rôle).
Runar Runarsson filme cette société en perpétuelle mutation avec une pudeur lyrique du désarroi et de l'exaltation. Il enregistre de manière extrêmement délicate des morceaux de vie dont l'enchaînement et la juxtaposition des plans, denses et disparates, dessinent peu à peu la grande et la petite histoire de l’Islande et de ses habitants. Les personnages y expérimentent une étroite liberté à travers le recentrage des flux familiaux et sociaux. Chacun retrouvera dans ces instantanés un élément familier issu de sa propre expérience individuelle et collective, des instants ordinaires, cocasses, amers et poignants d’où s’échappent des plans fulgurants à la beauté sourde et muette. Sont ainsi évoqués l'implosion de la cellule familiale, les dérives sociétales et politiques, l'immigration, le capitalisme, les disparités sociales, la prédominance des écrans, la représentation de pratiques et de coutumes, etc.
On songe aux cinéastes Roy Andersson ou Michael Haneke au début de sa carrière, potentiels inspirateurs, pour l'économie de plans, la sensibilité picturale et le resserrement narratif. Mais la comparaison reste très réductrice tant Runar Runarsson insuffle un élan prometteur et enthousiaste au paysage cinématographique islandais.