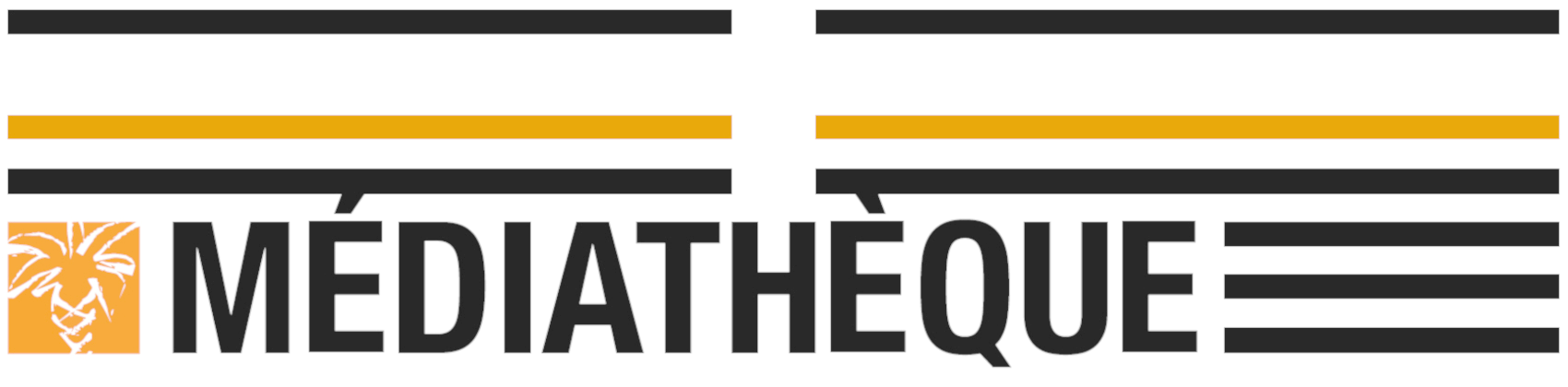Ce long métrage, assourdi de l'intérieur par un gouvernement censeur, arrive d'un lointain chaos, et marque un ton résolument nouveau dans la cinématographie iranienne. Ce joyau est réapparu comme l'une des œuvres les plus étonnantes de la Nouvelle Vague prérévolutionnaire islamique du pays.

En fusionnant les influences du modernisme européen, de l'horreur gothique et de l'art persan classique, Mohammad Reza Aslani crée un film d'ambiance délicieusement sobre qui éclate en un acte final subversif dans lequel les conventions de classe, les rôles de genre et le temps lui-même sont bouleversés avec une férocité choquante.
Le film a été tourné trois ans avant la fin de la dynastie Pahlavi qui a succédé aux Qajars. En raison de l'ombre d'un Shah largement impopulaire qui a plané sur les artistes les plus engagés et les plus audacieux de son royaume, de nombreux films iraniens des années 70 sont emprunts de sentiments de tristesse, de mécontentement et de dissidence.
Mohammad Reza Aslani vient de cette Nouvelle Vague iranienne (1969-1979). Il est aussi théoricien de l'art, graphiste et poète, une gamme artistique qu'il met au service de L’Échiquier du vent, son premier long métrage de fiction. Il en réalisera seulement deux, étant essentiellement connu pour ses films expérimentaux et ses documentaires. Bien qu'il ne l'ait jamais signé, il est co-auteur du Manifeste de « l'espacementalisme » qui regroupait de jeunes poètes et artistes iraniens qui revendiquaient une nouvelle définition de la poésie.
L’Échiquier du vent se déroule au début des années 1920 sous le signe de la dynastie Qajar. Il dépeint les répercussions du décès de la matriarche d'une famille noble dont les héritiers potentiels se disputent le contrôle de la succession. Dès lors, ils engagent une guerre pour le pouvoir et la richesse, piégés entre les murs oppressants de leur manoir, mus par la cupidité, la violence, la trahison, et le meurtre. La femme ostensiblement responsable est une paraplégique qui passe une grande partie du drame dans un fauteuil roulant, servie par une servante dévouée.

L'histoire du film fascine autant que le film lui-même. Après une projection publique unique au Festival international du film de Téhéran en 1976, et face à l'hostilité critique, L’Échiquier du vent est immédiatement interdit pendant la révolution iranienne, accusé d'être un produit culturel séditieux. La pellicule est confisquée mais le film circule sous le manteau dans une copie VHS déplorable.
Bien que considérés comme perdus pendant quatre décennies, les négatifs originaux sont miraculeusement découverts en 2015 dans une brocante à Téhéran, par Amin, le fils du cinéaste.
Avec l'aide de la Cinémathèque de Bologne, de la Film Fondation de Martin Scorsese, et de l'Image Retrouvée de Paris, L’Échiquier du vent a bénéficié d'une copie magnifiquement restaurée.
La réaction répressive du pouvoir en place ne surprend pas quand le film affiche explicitement de nombreux interdits, comme l'homosexualité ou l'omniprésence d'un comportement humain corrompu qui ne résiste pas à la ladrerie et à la trahison pour arriver à ses fins. Il médite sur une société où les valeurs spirituelles et sociales traditionnelles sont déplacées par un matérialisme corrosif. Le monde décrit est une hiérarchie typique des monarchies sclérosées.
A plusieurs reprises nous voyons un groupe de lavandières laver du linge dans une fontaine devant le manoir, et commenter à la manière d'un chœur grec la vie dans leur milieu social, foncièrement opposée à celle de la noblesse déviante. Car le huis clos intérieur isole la folie belliciste de chaque protagoniste et en concentre l'aliénation.
Le manoir est d'ailleurs l'un des personnages les plus importants du film. De couleur sable avec de hautes colonnes, des portes et des fenêtres décorées de vitraux éclatants, cet édifice persan archétypal n'est pas seulement là où le drame se produit. La famille est dans un tel état d'effondrement que la maison représente à la fois une vision insaisissable de la stabilité mais aussi la richesse dont tous ont soif.

L’Échiquier du vent est fier de sa différence, c'est une création virtuose hypnotique, un tour de force stylistique baignant dans une atmosphère baroque dont la somptuosité plastique et sophistiquée des images redonne une place prépondérante au montage.
L'inventivité éblouissante d'Aslani ne cesse de surprendre et nous entraîne dans des scènes raffinées et référencées. Les tons ocrés des intérieurs luxueux des étages supérieurs éclairés à la lueur des bougies ou à la lumière naturelle rappellent le Barry Lyndon de Kubrick, tandis que le sous-sol, repaire de crimes et de secrets, revêt une chromatique plus froide avec des rouges, des noirs, des violets. On songe également à Sergueï Paradjanov pour le travail d'orfèvrerie de la construction des plans, son souci méticuleux du détail, des objets et des accessoires. Le film évoque enfin l'admiration avouée du cinéaste pour Max Ophüls.
Ajoutons que l'expressivité des éléments visuels s'étend aussi bien à sa conception sonore qu'à sa partition musicale.
Aujourd'hui encore la critique sociale incisive et dévastatrice de ce drame est déroutante.
Malheureusement les films issus du mouvement de la Nouvelle Vague iranienne sont encore peu connus en dehors de l'Iran. Il est donc capital de découvrir ce chef d’œuvre ressuscité, riche, complexe, parfois opaque, que la censure avait tragiquement condamné.
Il incarne l'une des plus belles thaumaturgies cinématographiques !