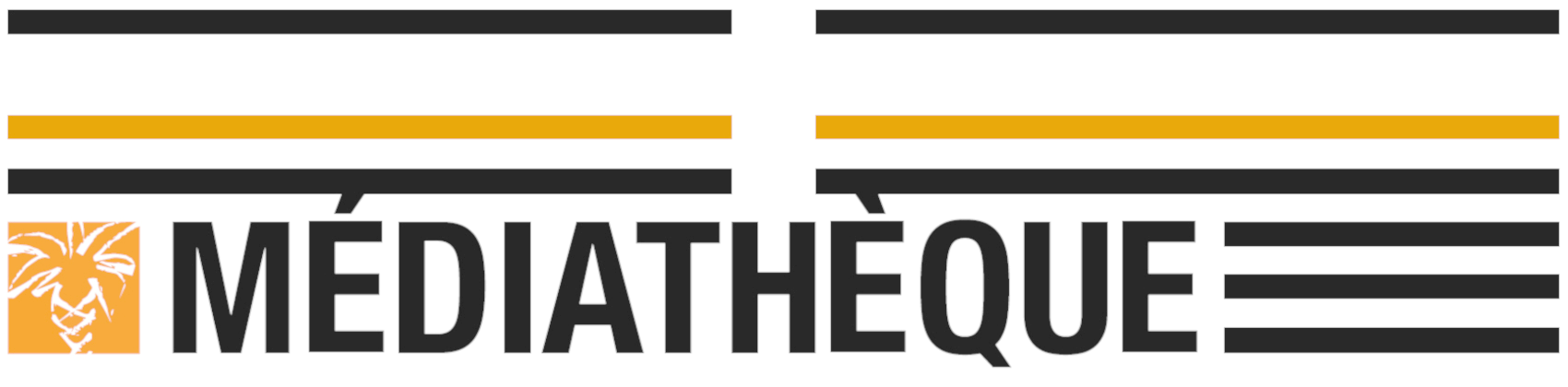Dans la démesure de la Taïga, Mikhaïl Kalatozov n'oublie jamais la mesure de son point de vue pour livrer un film à la temporalité patiente, linéaire, mais totalement ébranlée par les changements de saisons et le déchaînement des éléments, faisant de La Lettre inachevée (1959) une œuvre à part, sidérante de beauté.

Un premier plan sublime, large, présente les quatre membres de l'expédition soviétique débarquant sur le littoral. La caméra est placée sur l'hélicoptère et au fur et à mesure de son décollage, les personnages sont réduits à des points dans le paysage sauvage, tentaculaire et primitif. En quelques secondes, sont définis à la fois la tonalité de La Lettre inachevée, et le style de Kalatozov : une lutte constante entre l'harmonie et la disharmonie, l'unité et la fraction.
Cette équipe recherche un gisement de diamants dans le plateau sibérien central. Désireux à la fois d'assurer leur gloire personnelle et de mettre fin à la dépendance soviétique à l’égard des diamants étrangers, le groupe poursuit sa tâche sans relâche, avec persévérance et méthode, en explorant les terres et les rivières. Leur travail porte ses fruits mais le jour de leur départ, un incendie de forêt les pousse plus loin dans le désert. Le chef Sabinin écrit chaque jour à sa femme, complétant la lettre qu'il a négligé d'envoyer avant de s'embarquer dans l'avion pour la Sibérie. C’est une correspondance sentimentale et une réflexion personnelle sur le travail de l'expédition.
Les Français ont eu leur Nouvelle Vague, les Russes, leur cinéma du dégel (1953-1968). Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev, nouveau chef de l'Union soviétique, devient le bâtisseur du changement en donnant libre cours à la vie intellectuelle et culturelle. Avec l’émergence d’un climat cinématographique plus libre, des cinéastes établis osent expérimenter à nouveau. Dès lors, une nouvelle génération de talents issue de l’académie de Moscou (parmi lesquels Andreï Tarkovski ou Larissa Chepitko) apparaît. Mikhaïl Kalatozov, d'origine géorgienne, commence à faire des films à l'ère du muet. En 1931 son moyen métrage Un Clou dans la botte rencontre des problèmes de censure entraînant la mise à l'écart de son réalisateur pendant sept ans. Plus tard, sa collaboration avec le directeur de la photographie Sergei Urusevsky engendre trois œuvres fulgurantes. Quand passent les cigognes (1957) - seul film soviétique à avoir remporté la Palme d'or à Cannes - et Soy Cuba (1964) connaît une grande popularité auprès des cinéphiles, tandis que La Lettre inachevée n'obtient qu'une faible reconnaissance internationale. Notons que dans l'un des rôles principaux le cinéaste retrouve la beauté radieuse de son actrice Tatiana Samoïlova (Quand passent les cigognes).

Kalatozov élabore une mise en scène profonde, exubérante et très mobile, utilisant souvent des travellings virtuoses pour créer ses effets. Les cadres d'une image, même au repos, débordent d'une émotion fébrile, les plans audacieux se succèdent avec une endurance stupéfiante, des formes humaines sont éclipsées ou agrandies avec désinvolture. Dans un plan, elles peuvent sembler être l'élément dominant, dans le suivant, elles peuvent se noyer dans le bourbier des formes et des lignes. L’espace, le paysage, la matière changent radicalement de nature en très peu de temps en mettant progressivement les personnages en marge de l’existence. Au début du film, une sorte de quadrilatère amical, composé du chef Sabinin, d’un jeune couple d’universitaires éperdument amoureux, et du guide de l’expédition, un homme bourru et imposant, se forme, alors que la forêt exaspérante et impitoyable commence à éroder l'heureuse unité du groupe. La Mère Russie quant à elle n'est représentée qu'à travers une voix à l'autre bout de leur radio, leur seul lien avec la civilisation et la vie moderne. Elle peut recevoir des transmissions mais ne peut pas envoyer leurs signaux de détresse. De fait, la petite voix les félicite pour leurs réalisations alors qu'ils luttent contre les dangers de la glace et du feu. Le film reflète également l’idéal socialiste d’individus héroïques qui sacrifient leurs rêves et leur vie pour faire avancer les objectifs de la Révolution. Il célèbre la volonté soviétique de suprématie industrielle tout en suggérant que le progrès a un coût luxuriant.
La Lettre inachevée est l'un de ces films de survie, orné de rumination philosophique, d'ambition égarée et de dévastation émotionnelle, constamment accompagné de plans incroyablement beaux et méditatifs. Cette entreprise met parfaitement en valeur la bataille entre la volonté humaine et la nature impitoyable. Les personnages endurent le feu, le vent, la neige, la boue - motifs visuels récurrents - parfois nettoyés par la pluie porteuse d'espoir. Tous ces éléments propulsent l'intrigue, certains préfigurant le désastre à venir. L’espace est sans cesse en déséquilibre interne : chaque plan fait sentir à la fois la possibilité de faire face au danger, et ce qui le menace. Kalatozov fonde son esthétique et son propos sur un espace non fiable. Il écarte volontairement les intrigues qui auraient pu se nouer entre les personnages pour canaliser sa vision de cinéaste sur la construction très stylisée du paysage infernal, prison agressive hérissée d’aspérités mortifères.

La Lettre inachevée est une aventure universelle à l’esthétique visuelle éblouissante. Face aux forces obscures de la nature, et à la résilience humaine, Kalatozov nous offre un cauchemar des quatre saisons virtuose et spectaculaire.