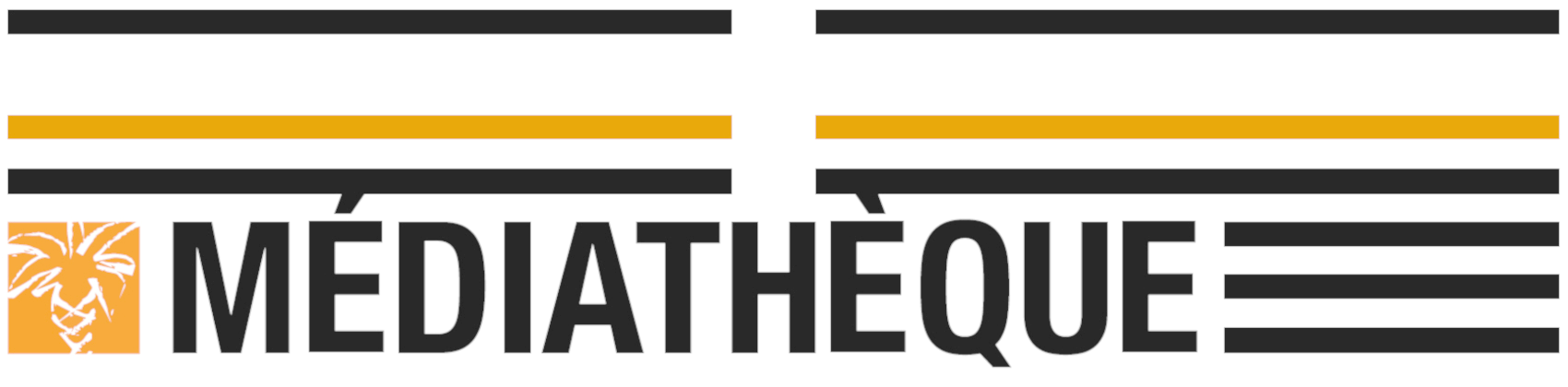François Ozon nous offre en cinquante-deux minutes un grand film pensé comme un thriller horrifique et psychotique lardé de paradoxes. En cultivant la noirceur du film de genre, le cinéaste s'empare de ce registre en y ajoutant un ton très personnel et une virtuosité éloquente.
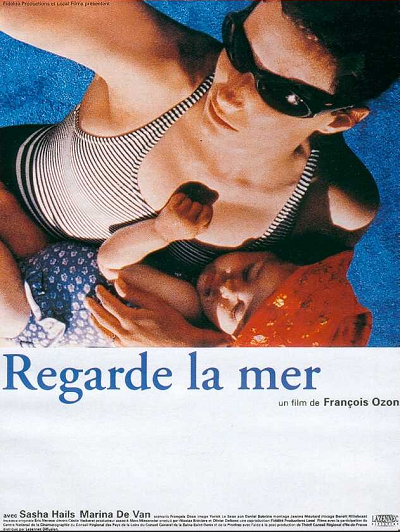
C'est l'été, Sasha, une jeune Anglaise, passe les vacances sur l'île d'Yeu avec son bébé de dix mois dans une maison isolée. Cette échappée paisible et solaire va rapidement se dérégler avec l'irruption de Tatiana, une jeune routarde taciturne qui lui demande l'hospitalité et l'autorisation de planter sa tente dans le jardin. Commence alors un duel féminin féroce dans un huis clos en plein air.
Dès ses premiers courts métrages au début des années 90, François Ozon se construit un univers identifiable, très structuré, travaillé par des obsessions tenaces. Deux orientations se détachent néanmoins. Ses films portent souvent un regard transgressif et provocateur sur la société et sur la sexualité tandis que d'autres films se veulent plus intimistes.
Le moyen métrage Regarde la mer (1997) est le premier film de l’auteur à bénéficier d’une distribution en salles. Il inaugure une filmographie éclectique et riche (à raison d'un film par an globalement) qu'Ozon élaborera dans des œuvres aussi bien hétéroclites qu’inégales.
Peter von Kant, son dernier opus, avec Denis Ménochet et Isabelle Adjani, sortira le 6 juillet, librement adapté des Larmes amères de Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder. François Ozon s’était déjà emparé d’une pièce du cinéaste allemand avec Gouttes d'eau sur pierres brûlantes en 2000.
Le film s'ouvre sur une frange écumeuse, entre la vague et le sable, amorce du ressac psychologique d’un récit qu'on devine hautement anxiogène. Ozon capte ensuite un rare moment de sérénité estivale entre une mère et son bébé en train de faire une sieste sur la plage. L’apparition d’une vagabonde emmitouflée dans des vêtements d’hiver et surplombant la douceur de cette scène (tel un rapace épiant ses proies), esquisse le processus de destruction au milieu de la beauté généreuse d’une nature ardente fissurée par le danger.
Les premiers plans induisent d'emblée le récit linéaire qui suivra, et annoncent les séquences de cataclysme qui le troue régulièrement, avant de venir contaminer l’ensemble de la fiction. Dans chaque séquence, la menace se fait plus nette, mais elle a toujours été là, elle est juste vouée à se préciser. On ne sait sous quelle forme elle prendra, le cinéaste conjuguant brillamment la rhétorique elliptique des films à suspens.
Le trouble omniprésent est d’autant plus oppressant qu’il ne se passe pas grand-chose dans ce théâtre de la vie ordinaire. La succession - concise et précise - des plans passe par de brusques ruptures de ton, de rythme, par de soudains accès de violence contenue. La terreur diffuse abandonne le spectateur dans une attente constante et un questionnement abyssal.

Ozon repousse les limites du genre avec un naturalisme délicieusement ironique en chargeant son film d’un symbolisme sexuel viscéral. Un lien étrange se noue entre les deux femmes, souligné par une menace orchestrée dans la confusion. Cette incarnation du mal devient de plus en plus ambiguë, la figure la plus diabolique n’étant peut-être pas celle qu’on croit. De quel côté se situe le danger ? Chaque personnage évolue dans un univers intime malaisant, entre candeur et cauchemar et Ozon nous promène assurément dans le dédale obscur d’un ou de deux esprits démoniaques.
Ce qui unit les deux femmes, c'est ce qu'elles symbolisent l'une pour l'autre. Tatiana investit l’espace maternel insidieusement et avec aplomb. Elle incarne les désirs refoulés de Sasha et déclenche en elle une tension sexuelle lugubre qu'elle ne peut contrôler. Car Sasha est fascinée, voire vampirisée par l'attitude prédatrice de Tatiana, et aspire à sa liberté et à son indépendance, sans contraintes domestiques.
Sasha est une mère aimante mais dangereusement irresponsable en laissant son enfant seul à plusieurs reprises afin d’assouvir ses pulsions. Elle confie aussi la garde de sa fille à Tatiana, cette inconnue venue de nulle part, sale, mal élevée, au visage opaque, hermétique aux émotions, et qui pose des questions embarrassantes et toujours plus scabreuses.
Car Tatiana est à son tour jalouse de la jeune femme sédentaire symbolisée par le bébé. Les scènes qu'elle partage avec lui sont d’ailleurs extrêmement déstabilisantes. Elles présagent à chaque fois un drame indéfinissable malgré la banalité d’un geste, d’un regard, ou d’un comportement.

Le film explore à la fois l'abject et le tabou, la manipulation et le doute. Glaçant et sidérant, il aborde une vision acrimonieuse du chaos et du « mal de mère ». La maternité malmenée, la maternité sacrifiée.
Regardez la mère. Avec discernement.